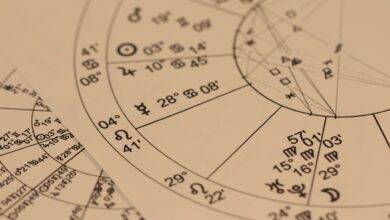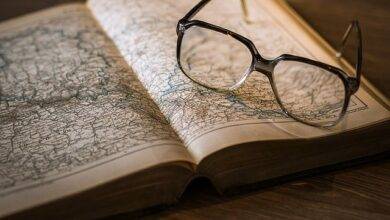Le temps des cathédrales
Souvent, tout commence là- bas, où est érigé un temple païen. Son emplacement n’est pas choisi au hasard : il est relié à un saint homme, enterré ici, aux forces naturelles et surnaturelles, qui peuvent guérir, prédire l’avenir, emmener vers les Dieux.
Chaque civilisation a ses lieux saints et ses temples. Au début, ce sont de petites constructions de pierre ou de bois, qui se détériorent facilement avec le temps et qui ne résistent pas aux combats et aux incendies. D’autres plongent dans l’oubli. Mais les croyances se transmettent de génération en génération et sur les anciens fondements et les vieilles ruines apparaîssent de nouvelles bâtisses religieuses : plus grandes, plus belles, plus solides.
Ainsi, les Romains, suivant l’exemple grec, construisent de merveilleux temples de marbre blanc, décorés avec des magnifiques statues et des nombreux pilons.
Au début du XIe siècle, vers l’an 1 000, après un longue période de troubles en Europe Occidentale, commence la construction des nouvelles églises. Leur architecture est inspirée de celle des Romains. Maintenant, elles ont des toits de pierre en voûte ronde. Leur plan suit celui de la basilique, leurs façades sont ornées de piliers et de chapiteaux sculptés, et leur intérieur de fresques et de statues de pierre, certaines couvertes d’or. Ce style architectural sera appelé plus tard « art roman ».
Au XIIe siècle, une technique différente de construction voit le jour : l’ogive : c’est un arc aigu formé de deux arcs de cercle d’un rayon égal et qui se coupent. Il déclenche l’art « gothique », qui fleurit entre le XIIe et le XVIe siècle.
Les Chrétiens bâtissent ses églises en forme d’une croix latine. La nef est tournée vers le soleil levant, vers Jérusalem. Selon les croyances du Moyen Age, plus un édifice religieux est haut, plus proche il ramène vers Dieu. Cet élan de « toucher » le Ciel donne naissance aux idées innovantes et aux techniques architecturales modernes, qui permettent la réalisation des élements géometriques et décoratifs, impossible d’accomplir jusqu’à présent. Pour la construction de l’église, on utilise de solides matérieux de bonne qualité ; on choisit des maîtres réputés et des ouvriers doués. Et la « petite » église se transforme en un nouveau joyau, la cathédrale.
Au XIIIe siècle, les architectes découvrent encore une autre technique révolutionnaire, la clef de voûte. Il s’agit de la dernière pierre, posée dans l’endroit courbé d’un arc, d’une voûte ou d’une coupole. Il rend possible l’élimination de la partie, qui les soutenait jusqu’à maintenant. Cette technique permet de répartir le poids de la voûte le long des arcs et des piliers, reliés avec elle. Les architectes changent la forme et les dimensions de la cathédrale, afin de lui assurer une meilleure stabilité. Ainsi, elle peut être élever de plus en plus haut.
Des arcs, des arcs- boutants, des piliers, des énormes fenêtres et des portails impressionnants, des rosaces colorées, des vitrages flamboyants, des sculptures presque vivantes, des gargouilles qui font peur… Tous ça « habille » la cathédrale de splendeur, lui donne une forme unique et une richesse indescriptible. Elle est un bijou terrestre, qui orne la ville, où elle était bâtie. Un bijou « offert » à Dieu pour lui montrer l’amour incontestable des Chrétiens. Un bijou, accesible à tous ceux, qui cherchent la grace et la lumière divine.
Au- dessus du porche, entrée de l’église, se trouve le tympan sculpté. Il permet aux paysans, qui ne savent pas lire, de comprendre les principaux épisodes de la Bible.
Une fois dans la cathédrale, le Chrétien découvre son intérieur. Il entre dans la partie principale du bâtiment, la nef, qui ressemble à un bateau renversé. Deux éléments encore sont typiques du style architectural gothique : le transept et le choeur. Le transept est une nef supplémentaire, perpendiculaire à la nef principale, qui la coupe de façon, à former une croix. Le choeur est la partie de la nef, qui se trouve devant le maître- autel.
La construction d’une cathédrale dure pendant des siècles. Autour d’elle « poussent » de véritables villes, où cohabitent tous les travailleurs impliqués à cet ouvrage : peintres, maîtres verriers, sculpteurs, charpentiers, tailleurs de pierre, forgerons. En plus de son salaire, le maître architecte est logé et nourrit.
Le travail est épuisant et exigeant. En plus, en hiver, il devient impossible à cause du froid. Alors, pendant cette saison le travail est interrompu.
Dès la première pierre jusqu’à la finition de sa construction, la cathédrale devient le témoin de nombreux événements historiques désastreux, qui perturbent son avancement : les maladies comme la peste Noire, les Croisades, la guerre de Cent Ans, les mauvaises récoltes et la famine, les cathastrophes naturelles, les guerres, le manque de financement. Mais malgré tous les obstacles, la croyance infaillible des Chrétiens et leurs efforts communs dépassent tout le reste. Ainsi, des cathédrales se dressent fièrement dans toute leur splendeur.
Aujourd’hui, on peut admirer le travail accompli des maîtres et des ouvriers, qui ont bâti de vrais bijoux architecturaux.
Voici quelques cathédrales de France très impressionnantes :
La basilique de Saint- Denis est la plus ancienne. Sa construction date de 1140.
La cathédrale de Strasbourg est la plus haute avec ses 142 m. Elle est aussi celle dont la construction a été la plus longue : plus de 250 ans.
La cathédrale d’Amiens est la plus vaste avec ses 145 m de long sur 43 m de large.